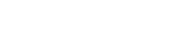1. Risques accrus à l'approche de l'été
L’augmentation de l’activité des parasites externes au printemps et en été expose les chiens et chats à diverses infections vectorielles pouvant être zoonotiques, dont la maladie des griffes du chat, des vers digestifs, la piroplasmose, l’ehrlichiose, l'anaplasmose ou encore la leishmaniose.
Ces infections, parfois asymptomatiques, peuvent aussi se manifester par des fièvres d’origine inconnue, troubles hématologiques, atteintes rénales ou dermatologiques. Une prise en charge préventive ciblée est donc essentielle.
2. Prendre en compte l’impact environnemental et les expositions des personnes au contact de ces molécules
Les antiparasitaires externes les plus utilisés (isoxazolines, perméthrines, fipronil, etc.) présentent une efficacité démontrée contre les parasites externes mais plusieurs publications et agences de santé (ANSES, EFSA) alertent sur :
- Leur persistance et bioaccumulation dans l’environnement
- Leur toxicité aquatique (impact sur invertébrés)
- Le risque de résistance si leur usage est systématique
- L’exposition de certaines populations à risque via les applications externes (spot on, collier, shampoing) comme les jeunes enfants ou les femmes enceintes
La contamination des eaux de surface a lieu via les baignades et les douches des animaux mais également via les eaux usées (lavage des tissus en contact avec l’animal, lavage des mains ayant touchées l’animal…)
3. Vers une stratégie antiparasitaire raisonnée
L’approche actuelle en médecine vétérinaire vise à être contextualisée, ciblée et saisonnière, fondée sur l’évaluation du risque réel pour chaque animal :
a) Évaluer le niveau d’exposition
- Milieu de vie et mode de vie : animal d’intérieur / citadin / rural / forestier ;
- Présence avérée de parasites et zones endémiques des maladies (par zones géographiques : consulter les bulletins entomo-épidémiologiques, alertes régionales à suivre : ASR ou DDPP) ;
- Possibilité de surveillance mécanique et visuelle (poils, taille, caractère)
- Autres pathologies (allergie aux piqures de puces)
- Antécédents : un animal ayant déjà été infecté (ex. babésiose) mérite une attention renforcée. À l'inverse, en l'absence d'antécédent et si le risque environnemental est faible, un traitement systématique peut être évité.
b) Privilégier des molécules moins persistantes
Il est préférable d’éviter les molécules très écotoxiques (fipronil, perméthrine) sauf lorsqu’aucune alternative n’est possible (protection contre les phlébotomes vecteurs de leishmaniose). Le report s’effectue souvent sur la famille des isoxazolines dont la toxicité environnementale est encore très peu évaluée. Certaines molécules de cette famille, à excrétion fécale, permettent le ramassage des fécès pour réduire l’impact environnemental du traitement
c) Choisir la galénique adaptée
Du fait de la persistance et du transfert de certaines molécules dans l’environnement et de la sensibilité de certaines populations plus à risque, les comprimés doivent être privilégiés dans certaines circonstances :
- Présence de jeunes enfants dans le foyer ou d’une femme enceinte ;
- Chien qui se baigne ou lavé fréquemment ;
- Chien/chat partageant la literie.
d) Associer des mesures non chimiques
- Inspection quotidienne des zones à risque chez l’animal (tête, oreilles, aisselles) ;
- Inspection régulière à l’aide d’un peigne anti-puces ;
- Tonte raisonnable et brossage post-promenade ;
- Tenir un journal de surveillance parasitaire par le propriétaire ;
- Enlever les tiques manuellement avec un crochet adapté, suivi d’une désinfection.
e) Informer les propriétaires
- Des risques des antiparasitaires pour l’environnement (pollution des rivières, toxicité des eaux usées, contamination des sols) ;
- De l’intérêt d’un traitement ciblé, non systématique, en fonction de la saison, du contexte local, de l’animal et de son mode de vie lorsque cela est possible.
- Des bonnes pratiques d’utilisation de ces traitements.
- De la nécessité d’une analyse de risque par un professionnel
4. Bonnes pratiques pour les vétérinaires
- Proposer une consultation antiparasitaire de printemps pour évaluer le profil épidémiologique de l’animal ;
- Doser le traitement : prescription à l’unité si possible ;
- Proposer des alternatives mécaniques ou naturelles ayant démontrées leur efficacité ;
- Proposer des kits de détection précoce ou des tests sérologiques si suspicion clinique ;
- Former les jeunes vétérinaires et les ASV à l’écologie et à la pédagogie du bon usage des antiparasitaires (un module existe depuis 5 ans, en Formation continue et initiale à l’initiative du SNVEL*) ;
- Sensibiliser à l’élimination des emballages de ces anti-parasitaires par une filière adaptée (incinération, pharmacie ou cabinet vétérinaire).
Les maladies vectorielles à tiques représentent un véritable défi pour la médecine vétérinaire de demain. Les vétérinaires et les pharmaciens ont un rôle clé à jouer dans la transition vers des pratiques antiparasitaires plus raisonnées. Avant l’été, c’est le moment idéal pour mettre en place une prévention adaptée au risque réel, limitant l’usage systématique de molécules à fort impact environnemental, tout en assurant la protection de l’animal, du foyer et de l’écosystème. L’éco-prescription devient un pilier de la médecine vétérinaire responsable.
SOURCES :
* SNVEL : Syndicat National des Vétérinaires d’exercice Libéral.
- ASEF – Mini-guide santé des antiparasitaires externes (2024)
https://www.asef-asso.fr/production/mini-guide-sante-des-anti-parasitaires-externes - Rosemary Perkins et al., 2023 – “Down-the-drain pathways for fipronil and imidacloprid applied as spot-on parasiticides to dogs: Estimating aquatic pollution”, Science of The Total Environment, Mars 2024
- ANSES. (2023). Mémorandum sur l’impact environnemental des antiparasitaires vétérinaires.
- EFSA. (2022). Risk assessment of parasiticides in the aquatic environment.
- Beugnet, F., & Franc, M. - Insecticide and acaricide molecules and/or combinations to prevent pet infestation by ectoparasites. Trends in Parasitology, 2012.
- Fournié, G. et al. - Tiques et maladies vectorielles chez les carnivores domestiques en France. Bulletin épidémiologique Santé Animale et Alimentation, Anses, 2020.
Par Floriane Lanord