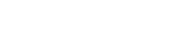Quel était le thème général de cette 30ème édition du « CAMU » ?
Ce congrès était très axé sur l’évolution de notre profession. Nous sommes sur un virage sanitaire global, une mutation du système de santé. Comme je l’ai dit en introduction, il faut qu’on arrête de penser que le système est en crise. Il est juste en train de se transformer. C’est à nous d’accepter cette transformation et de faire en sorte que nos pratiques correspondent au contexte dans lequel on évolue et aux attentes de nos patients.
À quel titre y participiez-vous ?
Je suis invité à y participer depuis deux ans en tant que président du syndicat Samu-Urgences de France. Il est important, quand on assume une fonction de représentation nationale, de participer à ces événements régionaux où l’on retrouve la communauté médicale d’un territoire. Ce sont des endroits de cohésion et de partage, des moments de sympathie et d’échanges professionnels. Il est essentiel qu’au niveau national, nous ayons ces visions locales sur lesquelles s’appuyer.
L’une des tables rondes s’intitulait « Effecteur, régulateur : apprendre à mieux se connaître », ce n’est pas encore le cas ?
Il existe deux mondes dans le système de santé, le libéral et l’hospitalier et ce sont deux blocs qui très souvent s’ignorent encore. Parce qu’ils estiment ne pas évoluer dans les mêmes temporalités et ne pas avoir les mêmes besoins, alors qu’ils sont, en réalité, interdépendants l’un de l’autre.
L’arrivée du SAS (Service d’accès aux soins)* a introduit un nouveau paradigme. Tout d’un coup, on met en place, dans chaque département, un dispositif qui appartient autant au monde libéral qu’au monde hospitalier.
Avec quels résultats ?
C’est la première fois, dans mon exercice professionnel que je rencontre un dispositif vraiment paritaire où chacun vient chercher quelque chose pour son propre exercice et pour améliorer la prise en charge du patient. Et ce n’est pas l’un qui impose son système à l’autre. Ce n’est pas la ville qui dit, vous, hôpital, on a besoin de vous pour faire certifier cela et inversement. Le SAS, c’est vraiment le SAMU et le monde libéral qui se mettent ensemble autour d’une même table pour organiser au mieux la prise en charge des soins non programmés et des urgences. Cela amène chacun à mieux comprendre les difficultés de l’autre et à mieux appréhender sa façon de travailler.
Une autre table ronde traitait de l’impact de la cocaïne sur les urgences, est-ce à dire que les hôpitaux reçoivent de plus en plus de patients sous emprise de drogues ?
Aujourd’hui, les drogues utilisées sont de plus en plus des drogues de synthèse et nous avons de plus en plus de mal à les reconnaître. Elles ne donnent plus les mêmes tableaux cliniques que l’on connaissait jusqu’alors, y compris pour la cocaïne. Initialement, c’est une drogue issue d’une plante, maintenant on a de plus en plus de cocaïne de synthèse qui ne donne plus les mêmes symptômes quand on a des intoxications importantes. L’idée était de faire un retour durant cette session sur ce qui est constaté par les centres de pharmacovigilance et les centres de toxicologie qui sont là pour nous conseiller quand nous sommes face à des tableaux cliniques compliqués.
Vous avez également présenté votre propre retour d’expérience sur les unités d’intervention paramédicalisées…
Oui, depuis plusieurs années, nous avons des infirmières, spécifiquement formées, qui sortent dans un Smur (structure mobile d’urgence et de réanimation) sans médecin. Ça marche très bien, à partir du moment où on encadre le dispositif de stricts critères d’indication de l’utilisation de ces moyens, avec un accompagnement bien formalisé et tracé par le médecin régulateur. Aujourd’hui, près 30% de notre activité répond à une pratique paramédicale du Smur. En deux ans, il n’y a jamais d’incident.
* Le SAS repose sur une collaboration étroite de l’ensemble des professionnels de santé d’un même territoire, qu’ils relèvent de la filière de l’aide médicale urgente (AMU) ou de celle de médecine générale. Cette collaboration se traduit par la mise en place d’un plateau de régulation des appels du SAS, accessible 24H/24 et 7J/7, auquel participent les deux filières : d’une part, la régulation médicale de l’aide médicale urgente (SAMU), et d’autre part, une régulation de médecine générale en journée pour les soins non programmés.
Propos recueillis par Pierre Nusswitz
Crédit photo : DR